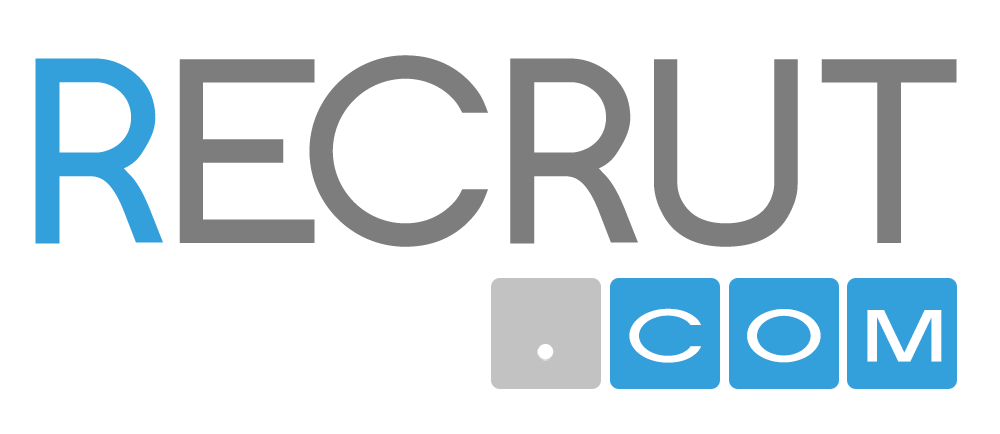Rechercher un article
Le bonheur en entreprise : un truc en toc ?



 « Il est où le bonheur, il est où ? » En entreprise, à en croire les mètres cubes de papiers, articles, rapports professionnels de tous poils qui traitent aujourd’hui de la question du bonheur au bureau. Il y a là de quoi s’étonner : pourquoi un tel regain d’intérêt pour une notion aussi floue, aussi idéaliste, aussi éloignée en apparence de la sphère professionnelle ? Qu’est-ce qui pousse les entités commerciales que sont les entreprises à jouer aux bons samaritains ?
« Il est où le bonheur, il est où ? » En entreprise, à en croire les mètres cubes de papiers, articles, rapports professionnels de tous poils qui traitent aujourd’hui de la question du bonheur au bureau. Il y a là de quoi s’étonner : pourquoi un tel regain d’intérêt pour une notion aussi floue, aussi idéaliste, aussi éloignée en apparence de la sphère professionnelle ? Qu’est-ce qui pousse les entités commerciales que sont les entreprises à jouer aux bons samaritains ?
Vendre du bonheur en boîte
En France, on aime les mots et on sait que ces derniers ont un sens. Prenez « travail », par exemple. On a bien intégré qu’il découlait du latin « trepalium », un instrument de torture romain utilisé pour punir les esclaves rebelles. Il n’est donc guère étonnant que travailler soit considéré dans nos contrées latines comme un ciment servant à structurer la société, à faire rentrer dans les rangs du pragmatisme les fantasques et la mauvaise graine. Un mal nécessaire par lequel on obtient sécurité financière, et ainsi tranquillité et statut social. Mais aujourd’hui, la machine se grippe. La crise, l’explosion de la population active, et voilà le contrat rompu : le travail ne garantit plus la stabilité, il n’est même plus garanti lui-même. D’où l’émergence d’une nouvelle génération (dite « Y ») pour qui travailler n’est pas un vecteur d’ascension mais une fin en soi. Certains de connaître des accidents de parcours et des périodes de précarité, ils s’attachent au sens de leur activité et à leurs conditions d’exercice. Etonnamment donc, malgré les difficultés à s’insérer sur le marché de l’emploi, les nouveaux actifs ne sont pas prêts à accepter n’importe quoi et se montrent très regardant sur le profil des entreprises.
Ces dernières, pour séduire ces « profils mercenaires », se voient contraintes de séduire, de prouver leur valeur et se vendre tel n’importe quel produit de consommation courante. On parle d’ailleurs de « marketing RH » pour décrire ce phénomène. Et de même que les shampoings ont eu leur période noix de coco ou aloe vera, le recrutement a ses tendances, ses toquades. Après la vague de la RSE (responsabilité sociale des entreprises) qui promettait des organisations transparentes et citoyennes, celle du « management agile » fondé sur l’ « intelligence collective », l’heure est donc au bonheur, au bien-être, à l’entreprise « bienveillante » qui vise l’ « épanouissement de ses collaborateurs ». L’acronyme tendance actuellement, c’est QVT (qualité de vie au travail).
Faire un peu, le dire très fort
Mais concrètement, ça veut dire quoi, être heureux au travail ? C’est là que les choses se corsent tant la notion est volatile et les attentes des uns et des autres, différentes. Les entreprises les plus motivées vont même jusqu’à se doter d’une personne uniquement chargée de répondre à cette question : un CHO, ou Chief Happiness Officer (responsable du bonheur). La mission de celui-ci est simple à définir : travailler au bien-être des salariés tout en perpétuant la culture d’entreprise. Les deux concepts doivent aller de pair, l’organisation intégrant le bien-être des salariés à ses valeurs et donnant ainsi à ces derniers l’envie de s’approprier cette culture d’entreprise. Ok sur le principe ; mais le flou entourant le statut du CHO en dit long sur la définition réelle que l’on prête à cette bienveillance. Ainsi, pour certains, il est avant tout un ergonome qui règle le bonheur des salariés comme on ajuste la luminosité des ampoules de l’openspace ou la hauteur des fauteuils de bureau. Pour d’autres, il est tout simplement un chargé de ressources humaines qui distribue du bonheur sous formes de plannings aménagés ou de fêtes d’équipe.
De quoi donner l’impression que le bonheur est une simple question de bidouillages, de gadgets presque. Parée de ses gages d’employeur bienveillant, l’entreprise peut partir en quête de candidats. Il n’est donc guère étonnant que la plupart des CHO soient en réalité intégrés au service « communication », ce qui pose la question –cynique– suivante : la mode du bien-être (ou « slow management », pour les fans de jargon) profite-il aux salariés ou l’entreprise elle-même ?
Bien être pour bien produire
« La volonté de redorer ou d’affirmer une marque employeur méconnue ou vieillissante, l’opportunité de renforcer la performance de son entreprise ou organisation ou encore la nécessité de se conformer à des obligations légales sont autant de raisons qui poussent les entreprises à répondre aux attentes et besoins de leurs collaborateurs », souligne le Groupe IGS dans un mémoire consacré aux liens entre marketing RH et performance1. Être une boîte bienveillante n’est donc pas tout à fait faire preuve de philanthropie. Après tout, un dirigeant n’est pas motivé par des fins humanitaires. « Il est difficile de différencier les entreprises qui se préoccupent réellement de leurs collaborateurs de celles qui s’en servent à des fins marketing uniquement. »
Et impossible d’être aidé dans cette tâche par les nombreux labels qui distinguent aujourd’hui les entreprises sympas. Trop nombreux, ils proposent chacun leur propre méthodologie et leur propre classement, rendant encore un peu plus flou cette notion déjà peu définie de « bonheur au travail ». Plus troublant encore : le leader du genre Great Place To Work, qui facture l’inscription à son audit et interroge ainsi la neutralité de ces classements qui survivent par l’argent des entreprises qu’ils évaluent.
« Mais, en définitive, quelles que soient leurs raisons, le plus important n’est-il pas qu’elles mettent en place des actions concrètes ? », interroge le Groupe IGS. Peut-être, mais communiquer sur sa bienveillance n’est pas toujours lié à la mise en place de dispositifs favorisant le bien-être des salariés. Une étude publiée chaque année par Weber Shandwick et KCR Research calcule ainsi la cohérence entre le message institutionnel des organisations et la réalité quotidienne de leurs collaborateurs… et les résultats ne sont guère concluants. En France, seuls 14 % des salariés interrogés estiment que l’image publique de leur boîte correspond à ce qu’ils vivent en interne [résultats 2017] ; ils sont même 6 % à parler de « total décalage ». C’est mieux qu’à Singapour et son record de 3 % de cohérence, mais nettement moins bien que les Etats-Unis qui comptent 21 % de satisfaits. Un résultat intéressant dans la mesure où le marketing RH et la QVT sont deux idées développées au pays de l’Oncle Sam. Si la France semble avoir bien compris les retombées positives pour les marques employeurs, il lui reste à développer le volet concret pour les salariés. « Le bien-être en entreprise, c’est ceux qui en parlent le plus qui en font le moins »
Les derniers articles