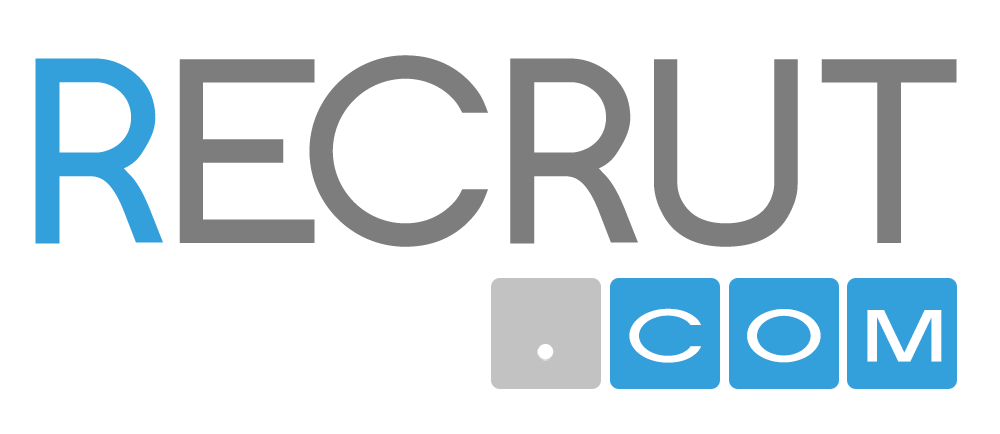Rechercher un article
Classer pour licencier : le scandale Sanofi




De quoi s’agit-il ? Pourquoi cette pratique fait-elle aujourd’hui débat ? Nous nous sommes penchés sur cette stratégie managériale qui officialise la loi du plus fort au sein de l’entreprise.
T’es top ou bottom ?
Il y a ceux qui prônent le « un pour tous et tous pour un » et voient les salariés comme des mousquetaires solidaires dans l’épreuve et la victoire. Il y a ceux qui croient aux binômes qui équilibrent type « les derniers seront les premiers ». Et puis il y a les adeptes du « chacun pour soi », de la raison du plus fort, bref, du « forced ranking ». Selon une enquête de plusieurs mois menée par France Inter, il semblerait que l’une des plus grande entreprise française (Sanofi, en l’occurrence) se classe dans cette dernière catégorie. Le souci, c’est qu’en France, le « classement forcé » est parfaitement interdit.
Comme bon nombre de techniques managériales, le « forced ranking » nous vient des Etats-Unis, où il fut théorisé et défendu par Jack Welsh, l’emblématique PDG de General Electric pendant deux décennies. Pour lui, l’avantage compétitif d’une entreprise réside dans la somme de ses talents ; pour monter en compétitivité, il suffit donc de virer les moins doués pour ne garder que les meilleurs. C’est ça, le classement forcé : un tri opéré parmi les employés à l’aide de quotas déterminés à l’avance. Dans la grande course à la performance qu’est l’entreprise, on estime ainsi qu’il y 20 % de bolides (Top 20), 70 % d’utilitaires nécessaires mais sans éclat (Vital 70) et 10 % de charrettes (Bottom 10). Chaque salarié ou manager est évalué, puis placé dans une de ces trois catégories.
La suite consiste à séparer le bon grain de l’ivraie en encourageant les Top 20 (augmentation, promotion) et licenciant les Bottom 10. Et en renouvelant l’opération tous les a ns. Evaluer, trier, dégager : les Américains appellent cela le « rank and yank ». De quoi, selon les adeptes de la méthode, augmenter les compétences des équipes de manière durable. « Année après année, la sélection hausse la barre d’un cran supplémentaire et augmente le calibre moyen », explique Jack Welsh.
| A lire aussi : La note sur vingt au piquet ! |
Et s’il n’en reste qu’un…
Aux Etats-Unis, on estime qu’entre 35 et 60 % des entreprises ont opté pour cette stratégie. Un résultat guère étonnant dans le pays natal de programmes télévisés tels que The Apprentice, dans lequel l’actuel résident de la Maison Blanche mettait en concurrence des demandeurs d’emploi pour les virer un à un sous les yeux de millions de téléspectateurs. En France, en revanche, le « classement forcé » est interdit, même si l’on considère qu’il est officieusement appliqué par 4 % des entreprises. Nul doute que ce chiffre grossira dans les années à venir, aidé en cela par les nouvelles modalités de licenciement contenues dans la Loi Travail Pénicaud (notamment la définition des objectifs dans le contrat de travail et le renvoi possible s’ils ne sont pas atteints).
Pourtant, chez l’Oncle Sam aussi la pratique compte des détracteurs. Certains adeptes tels que Microsoft ou Ford ont ainsi été traînés devant les tribunaux, accusés d’utiliser le classement comme outil de discrimination ; les femmes, les latinos, étaient en effet surreprésentés dans les Bottom 10. La dérive est possible et donc à prendre au sérieux. Cependant, c’est le concept même du « forced ranking » qui choque en France, en ce qu’il s’appuie non pas sur une logique d’examen (quiconque a la moyenne à son évaluation est validé à son poste) mais de concours. Autrement dit, même si l’équipe est très performante, 10 % de ses membres seront licenciés et le plus sûr moyen pour un salarié de garder son emploi est d’appuyer sur les épaules du collègue pour le maintenir au fond du classement. Le « forced ranking » n’est donc pas l’engrais naturel d’un progrès général des entreprises dû à l’entraide et la solidarité.
Par conséquent, dans un contexte de « classement forcé », l’objectif de l’évaluation n’est pas de déterminer les compétences d’un salarié, mais de placer celui-ci au sein du niveau global de son équipe. Jugé « moins performant » que ses collègues, il ne se verra proposer ni binôme ni formation mais sera licencié pour incompétence. Dans le système français, qui considère que l’entreprise est en charge de développer l’employabilité de ses collaborateurs et valorise la formation tout au long du parcours professionnel, un tel procédé est difficilement acceptable. La Cour de Cassation elle-même le juge « illicite » dans un arrêt rendu le 27 mars 2013 et devenu une référence. Sanofi, l’entreprise à l’origine du scandale actuel, rejette l’accusation et dénonce une dérive isolée. Reste que, à toutes les échelles et dans toutes les sphères, rendre des compte semble être la grande tendance du moment (chez les anglo-saxons, ce concept est désigné par le terme d’accountability). Emmanuel Macron lui-même va y exposer son gouvernement, lui qui souhaite soumettre ses ministres à une évaluation annuelle.
C. Véron
Gouvernement : une évaluation pour les ministres par francetvinfo
Les derniers articles